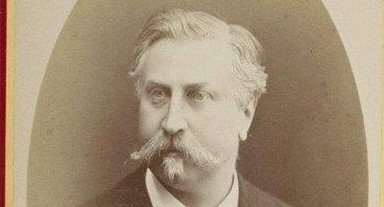Henri Pitot fait partie de ces génies du 18ème siècle, de ces savants de l’Ancien-régime qui honoraient la France de leurs savoirs.
Il compte au nombre des personnalités dont Montpellier et le Languedoc peuvent s’enorgueillir. On sait tous, nous autres Montpelliérains, qu’on lui doit l’aqueduc Saint-Clément, auquel on donne de façon usuelle son nom. Mais on ne connaît pas réellement sa vie… et c’est ce que nous allons vous conter à l’aide de plusieurs publications.
Henri Pitot naît le 31 mai 1695 au sein d’une famille bourgeoise installée à Aramon dans le Gard, mais dont la richesse avait été ternie par les Guerres de Religion. Sa famille paternelle était en fait originaire du village de Marguerite, aux riches plaines céréalières, et sa mère Jeanne de Julian appartenait à une famille en voie d’anoblissement de la prospère cité de Beaucaire.
Ce fils d’une famille nombreuse – dix frères et soeurs au total – entre en tant que pensionnaire au Collège des Doctrinaires de Beaucaire mais il n’est pas du tout séduit par leurs enseignements qui portent en priorité sur la grammaire, le latin et le grec.
Désespéré par le jeune Henri, son père décide de signer un acte d’engagement dans le régiment de Royal Artillerie. Sa carrière aurait pu être celle d’un cadet de famille, qui pour gagner son quotidien, se serait perdu sur un champ de bataille. Mais son destin fut autre, à l’image de ce qu’un prophète gardois avait prédit à ses parents : “Un jour il fera honneur à sa famille”.
C’est à partir de 1713 que sa vie connaît un autre horizon. Déambulant dans les rues de Grenoble où il vient d’être muté, il trouve un ouvrage qui attire son attention. Il s’agit d’un traité de géométrie. Il se passionne pour ce qu’il y découvre et sait dès lors que son avenir ne sera pas celui d’un militaire de carrière. D’ailleurs, au même moment, la paix de Rastadt est signée et met fin à la guerre de la succession d’Espagne et à ses engagements.
Il revient alors à Aramon dans la maison familiale, où il dévore la géographie du Père Labbe et construit une mappemonde sur laquelle il dessine mers et continents. Il se lance alors dans la lecture des travaux d’Euclide, Denis Henrion, Deschalès, dans l’arithmétique de Le Gendre et dans celle des traités d’arpentage et de balistique. Il se perfectionne encore et dévore des ouvrages plus complexes encore devant lesquels il ne baisse jamais les bras.
L’astronomie devient une passion. Il profite d’une tour de la maison paternelle pour y installer un observatoire depuis lequel il trace une méridienne et d’autres éléments d’astronomie. Depuis son belvédère, il se livre à de surprenants calculs mathématiques qui ne manquent pas d’interroger son père. Ce dernier demande alors à un abbé d’Uzès de tester l’étendue des connaissances de ce rejeton qui n’avait jamais brillé dans ses études. Le pauvre abbé qui devait être un érudit – ou pas – lui dit que son niveau d’instruction est surprenant et qu’il doit continuer ses études à Paris où est réellement sa place. Le cancre s’est transformé en savant au grand étonnement de son père qui, face à la détermination de son fils, n’a d’autres possibilités que de suivre les prescriptions du religieux.
En 1718, à l’âge de 23 ans, Henri part donc à la capitale armé d’une lettre de recommandation de la marquise d’Aramon auprès du grand physicien Réaumur. Il est particulièrement bien reçu par le savant qui lui ouvre son immense bibliothèque composée de livres traitant de tous les domaines. Il se passionne alors pour l’hydraulique et l’astronomie et passe quelques soirées à l’Observatoire où il travaille avec de jeunes apprentis qui, comme lui, espèrent entrer rapidement à l’Académie royale des Sciences et ainsi vivre de leurs passions.
Pour ce faire, il produit une étude très remarquée sur une éclipse de soleil prévue le 22 mai 1724. Il est le seul à trouver la durée de cette éclipse à l’aide des travaux de Le Hire et en publie les résultats dans le Mercure de France en 1722. Ses excellents résultats lui ouvrent la porte de l’Académie où il est nommé adjoint mécanicien. A l’âge de 32 ans, il est promu associé mécanicien avec un vote unanime de l’Assemblée. Cette audace ne lui permet toutefois pas d’entrer à l’Académie des Sciences dans la section Astronomie. Il est en effet doublé par un de ses confrères languedocien, le biterrois Jean Jacques Dortous de Mairan.
Cet échec ne lui fait pas baisser les bras. Au contraire… Il s’attache encore plus au service de Réaumur et l’accompagne dans le Nivernais, et plus particulièrement dans les forges de Cosne. Il étudie alors les porcelaines et les vernis, dont le succès devient de plus en plus important à la cour de Louis XV. En 1732, ce touche à tout de génie aide l’immense scientifique à mettre au point son thermomètre, – qui sera connu sous le nom de thermomètre de Réaumur – notamment en travaillant à l’étalonnage et au dessin des graduations.
Durant cette période, de 1724 à 1742, il rédige également trois mémoires d’astronomie, six de géographie, et cinq d’hydraulique. En 1731, il publie la théorie de la manœuvre des vaisseaux qui est traduit en anglais et cette traduction lui vaut en 1740 une brillante élection à la Société Royale de Londres.
En parallèle de ces travaux scientifiques, il découvre l’art de l’ingénierie et de l’architecture. Il surveille notamment le lancement d’un pont à l’Isle Adam et suit avec beaucoup d’intérêt la construction de la façade de Saint-Sulpice.
Débute alors la seconde partie de sa vie que nous conterons prochainement. Celle-ci nous conduira en Languedoc où le président-né de la province souhaite s’associer les talents de ce brillant scientifique et va lui confier d’importants chantiers : l’asséchement des marais d’Aigues-Mortes, de l’aqueduc Saint-Clément ou encore de doublement du Pont du Gard, parmi tant d’autres…