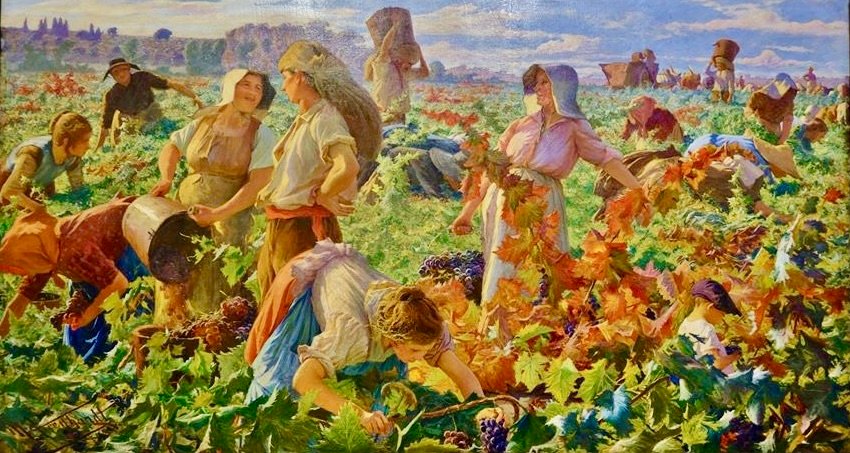Antoine Valedau compte parmi les généreux bienfaiteurs de la ville de Montpellier, qui, grâce à leurs dons, participèrent grandement à la constitution, des exceptionnelles collections du Musée Fabre.
Issu d’une famille notable de la ville de Montpellier, apparentée à Jean Jacques Régis de Cambacérès, Antoine Valedau, au soir de sa vie, envisage de prolonger l’initiative de François Xavier Fabre. Durant toute sa vie, il s’était passionné pour la peinture hollandaise et pour les grands peintres français du XVIIIème siècle, dont il avait recouvert les murs de son luxueux appartement parisien.
Sous la Révolution, l’Empire puis la Restauration, Antoine Valedau sut se faire un nom dans la capitale mais également une importante fortune. D’abord fournisseur aux armées, puis agent de change près de la bourse de Paris, fonction particulièrement lucrative, il se constitua une fortune remarquable, qui permit à ce célibataire d’assouvir sa passion pour l’art. Aucune vente où passaient des oeuvres majeures issues de prestigieuses collections, parfois de la grande aristocratie européenne, lui était étrangère.
Dans son élégant appartement parisien de la rue Basse-du-Rempart, il déploie ses précieuses collections d’art. Les écoles du Nord y sont particulièrement mises en valeur, avec des tableaux rares obtenus à des prix souvent élevés. Parmi ceux-ci, se trouvent aussi quelques peintures françaises, notamment des œuvres de Greuze d’une grande qualité. Il est un des premiers à s’intéresser depuis le vieux continent à la peinture anglaise. Il fait l’acquisition du Petit Samuel en prière de Joshua Reynolds.
Cet amateur d’art est également passionné par les maîtres néoclassiques et romantiques, comme en témoignent ses albums de dessins, et il aime s’entourer de magnifiques objets d’art, tels que des vases grecs, des coupes en albâtre, des figurines en marbre, et des bronzes issus de la Renaissance et du Grand Siècle.

Le testament d’Antoine Valedau
Le 11 février 1836, ce montpelliérain exilé à Paris, Antoine Valedau, sentant ses derniers jours arriver, s’installe à son bureau, avec la ferme intention de faire un cadeau à sa ville de naissance. Il se saisit de sa plume et trace quelques mots qui constituent son testament :
“Je donne et lègue au Musée Fabre fondé à Montpellier par la munificence et le soin de mon compatriote M. Fabre et qui porte son nom, tous les tableaux tant anciens que modernes, albums, dessins, gravures, statues, bustes en marbre ou en bronze, vases, coupes, vases étrusques, figurines et généralement tous les objets d’arts de quelque nature qu’ils soient et dont je n’aurai pas disposé qui garnissent mon appartement de Paris seulement.
Si à l’époque de mon décès, mes quatre albums avaient été laissés à ma campagne, ils seront compris dans la présente donation. Je désire pouvoir ainsi m’associer aux vues bienfaisantes et généreuses du fondateur de ce musée dans ma ville natale.”
Par ces quelques mots, qui rappellent l’exemple de François Xavier Fabre dont il s’inspire, il fait don au Musée Fabre et à la ville de Montpellier de sa prodigieuse collection, soit soixante-dix-neuf tableaux de grands maîtres des écoles française, flamande et hollandaise, trois cent quarante-cinq dessins et aquarelles, cinquante-cinq gravures, dix marbres, onze bronzes et dix-huit objets d’art.
La ville de Montpellier face à l’héritage
Quelques mois plus tard, le 7 décembre 1836, Antoine Valedau décède à Paris, dans son appartement.
Le conseil municipal est informé quelques jours plus tard des dernières volontés de l’ancien montpelliérain. Lors de la séance du 29 décembre 1836, les conseillers municipaux votent un budget de 6.000 francs “à l’effet de pouvoir aux divers frais que nécessitera cette affaire, laissant à M. le Maire, le soin d’aviser aux meilleurs moyens pour l’expédition et la conservation de la riche collection dont M. Valedau vient de doter la ville de Montpellier.” (source : AMMtp, 1D38)
Ainsi la ville de Montpellier complétait sa collection de tableaux et d’oeuvres, faisant entrer les tableaux de Greuze, mais surtout les prémices du cabinet de peintures hollandaises. Les plus grands amateurs d’art du XIXème siècle s’empressent de découvrir, donnant au Musée fondé par François Xavier Fabre en 1826, une visibilité de tout premier plan et lui conférant le statut de plus grand musée de Province. Rares sont en effet les villes qui disposaient d’une telle collection, associant tous les époques de la peinture. Les plus grands critiques vantent alors les collections du musée Fabre :
« Le musée de Montpellier, fondé comme on le sait par M. Fabre, qui avait le grand tort de n’en pas laisser assez jouir le public, vient d’être augmenté d’une riche collection de plus de 80 tableaux, dont le plus grand nombre appartient à l’école flamande. La ville de Montpellier doit cette nouvelle richesse artistique à l’un de ses plus honorables citoyens, M. Valedau : c’est ainsi que les nobles exemples trouvent toujours de nobles imitateurs. On pourra apprécier l’importance et le mérite de la galerie Valedau, par la seule énumération des maîtres dont les œuvres y figurent : ce sont d’abord Greuze, Rubens, et Reynolds, le Louvre n’a pas même une seule toile de ce dernier artiste, qui fait honneur à l’Angleterre ; puis viennent Gérard Dow, Miéris, Terburg, pour de charmans tableaux d’intérieurs, Téniers, Van Ostade, Karel Dujardin, Jean Steen, pour les scènes champêtres, si grivoises, si folles, si animées, comme les peintres de cette école savent les faire ; à côté figurent des scènes pastorales de Berghem et de Paul Potter; plus loin, de délicieux paysages de Wouvermans, de Wynants, de Ruysdaël, d’Adrien Van-den-Velde, puis des marines de Guillaume Van-den-Velde et de Knyp. L’école française n’est pas tout à fait oubliée dans la collection de Valedau, car on y retrouve un tableau de Mme Jacotot, d’après Girodet, et une page de ce grand peintre lui-même, représentant un sujet emprunté à la Divina Commedia du Dante. Le don Valedau comprend plus encore: des bronzes de marbres, des vases grecs et quatre albums de dessins modernes, qui n’ont pu être livrés encore à l’impatience du public, et qui renferment un grand nombre d’aquarelles et de sépia précieuses. Nous citerons entre toutes, une brillante scène du moyen-Age, par Bonington des dessins de Michallon, Gudin, E. Isabey Boissieu, Gérard, Girodet, etc. et enfin plusieurs charges spirituelles de Charlet. »
— Anonyme, Chronique, L’art en province, 1836-1837, p. 167 .
Apollon et Daphné
Parmi les oeuvres données par Antoine Valedau figure cet exceptionnel bronze “Apollon et Daphné” qui peut être considéré comme un des chefs-d’oeuvre de la sculpture du Musée Fabre.

Cette statue est due aux ciseaux de François Girardon (1628-1715), un des plus grands maîtres de l’art statuaire du règne de Louis XIV. Elle a été réalisée aux alentours vers 1700, à partir d’une oeuvre originale qui a été sculptée entre 1622 et 1625, par Giovanni-Lorenzo Bernini, dit le Bernin (Naples, 1598 – Rome, 1680) pour le cardinal Scipione Borghese. L’original est exposé à la Galerie Borghèse à Rome.
Cette sculpture, extrêmement vivante, représente le moment où Daphné se transforme en laurier pour échapper à Apollon. Elle reprend les traditions du mythe décrit par Ovide. La statue illustre la poursuite et la métamorphose avec un réalisme et une dynamique exceptionnelle, caractéristiques du style minutieux et dramatique du Bernin qui sut si bien être restitué par le grand maître français.
Bibliographie :
Collection du MUSEE FABRE, don Valedeau, 1836.
Photo Frédéric Jaulmes.
Pour plus d’informations :