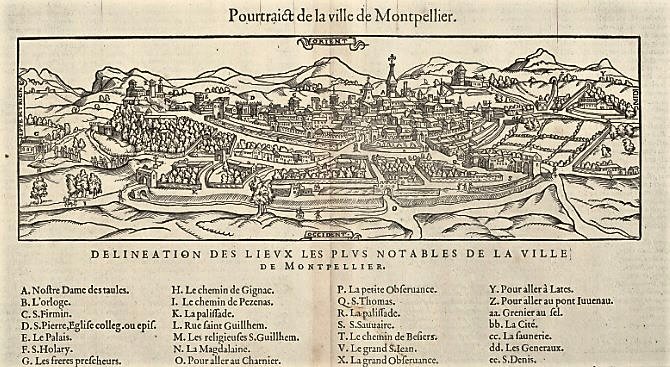Cette inscription chrétienne, qui s’est avérée fort précieuse pour l’amélioration de la connaissance de l’histoire régionale, a été découverte au Mas des Ports, sur la commune de Lunel en janvier 1893.
Cette propriété qui appartenait à la puissante famille protestante montpelliéraine Castelnau occupait le site d’une ancienne localité qui semblait avoir eu une certaine importance. Elle se situait en effet dans le voisinage de la côte de l’étang de Mauguio et disposait de deux églises, une dédiée à Saint-Pierre et l’autre à la Vierge Marie, toutes deux placées sous la dépendance de l’abbaye de Psalmodi. L’importance de cette localité qui semblait s’étendre sur au moins cinq cents mètres de long provenait d’un port qui avait été créé sur l’embouchure du Vidourle sur l’Etang de Mauguio.
C’est à l’occasion de labours, effectués au lieu-dit la Paillasse, dans le voisinage du site qui était occupé par l’ancienne église Saint-Pierre que cette pierre a refait surface. Elle était enfouie à environ 60 centimètres de profondeur.
M. Eugène Castelnau, le peintre bien connu de Montpellier, spécialiste des vues du Pic Saint-Loup, qui était habitué à voir remonter des profondeurs de ses champs des pierres sépulcrales, sans inscription, comprit immédiatement l’intérêt que cette pierre présentait pour la communauté scientifique. Il en fit don à la Société Archéologique de Montpellier.
Ses savants l’auscultèrent, se penchèrent au plus près des inscriptions qu’elle portait afin de savoir ce que cette pierre de 46 centimètres de haut, de 43 centimètres environ de large, et de 10 centimètres d’épaisseur avait à leur raconter.
Les inscriptions, portées sur 8 lignes entourées d’un bandeau en relief, n’étaient pas alignées, les lettres étaient inégales. Il s’agissait de toute évidence, de caractéristiques qui témoignaient de son ancienneté, mais également du peu d’expérience du graveur.
Le texte n’était pas intelligible, loin de là-même.
Le lapicide avait sauté des mots, les avaient rajoutés là où il put, intercalant au milieu de phrases d’autres mots qu’il avait oubliés précédemment. Il fallait dire que peu de personnes savaient lire, et donc bien peu seraient en mesure de juger de la médiocrité de son travail.
Mais les savants montpelliérains parvinrent à résoudre ce rébus historique et purent ainsi proposer cette traduction :
“In nomine nostri Domini Jhesu Christi. Hic requiescit Ramilo famula Dei et obiit pridii nonas Jenovarii. Vivat in Cristo. Amen”,
ce que l’on peut traduire par :
“Au nom de notre seigneur Jésus Christ, ici repose Ramila, servante de Dieu et morte le 4 janvier. Que son âme vive en Christ. Amen”
Mais l’intérêt était moins dans le texte que dans l’ancienneté de cette pierre sépulcrale. La façon de tracer les lettres, l’emploi de formules presque archaïques signifiait qu’elle appartenait à la haute antiquité et qu’elle datait d’une période qui précéda le règne des rois carolingiens. Ils étaient en face d’une pierre fort rare, témoignage d’une époque qui était assez peu documentée. Les travaux d’un chercheur renommé avait répertorié environ 200 pierres pour toute la France, et aucune pour notre secteur.
Après divers rapprochements, notamment l’étude de la formule “hic requiescit” qui à partir du début du 6ème siècle devint “hic requiescit in pace”, l’utilisation du titre “Famula Dei” qui n’est présente que sur des tombes datées d’une période entre 449 et 552, et l’étude des lettres, plus précisément du U et du V, les divers savants barbus de la prestigieuse Société Archéologique de Montpellier purent réduire l’intervalle de la fabrication de cette plaque. Elle avait été gravée entre 485 et 534 après Jésus-Christ et faisait donc partie de ces très rares vestiges de la période mérovingienne.
Après ces quelques éléments de datation, il convient tout de même de s’intéresser à la défunte, car il s’agit bien d’une défunte, une femme chrétienne, laïque, même si elle se dit “servante du Christ”, dont ceux qui firent édifier la tombe souhaitaient, par cette formule, rappeler sa piété. Elle était connue sous le nom de Ranilo, et ainsi que ce nom le laisse présager, elle appartenait à une famille d’origine germanique, assez rare dans le sud de la France. Au-delà de sa datation, cette pierre sépulcrale présente un intérêt historique, presque documentaire, car elle témoigne d’une époque fort peu documentée qui suit la chute de l’Empire romain et les troubles qui en résultèrent avec les passages des troupes germaniques, dont la défunte, célébrée par ces inscriptions était une des héritières…
Ce texte qui synthétise une étude réalisée par M. Cazalis de Fondouce en 1899 n’a d’autre intérêt que de rendre hommage à ces savants montpelliérains, membres érudits de la Société Archéologique de Montpellier, qui surent participer au renom de notre ville dans la communauté scientifique internationale.